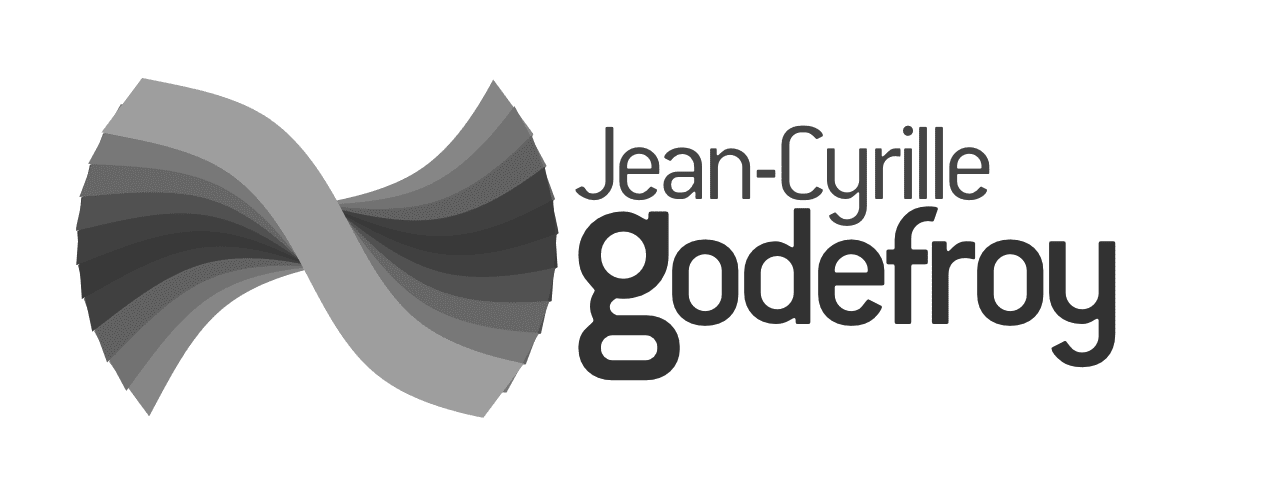20 février, 2025
Jean-Baptiste Noé
Les négociations entre les États-Unis et la Russie ont débuté à Riyad et devraient aboutir à une solution de paix. Mais ni l’Ukraine ni les Européens ne sont conviés, preuve de leur déclassement.
Donald Trump avait prévu de régler rapidement la question ukrainienne afin de pouvoir se consacrer sur ce qui est pour lui essentiel : la Chine (pour la puissance économique) et le Mexique (pour les routes des migrants et de la drogue). Les négociations ont donc débuté avec une Russie qui certes contrôle toujours près de 20% du territoire ukrainien, mais dont l’économie commence à faiblir de trois ans de keynésianisme de guerre. Vladimir Poutine a redit qu’il ne voyait pas d’inconvénient à ce que l’Ukraine rejoigne l’UE. Il l’avait déjà dit en 2022, mais c’est toutefois une évolution notable, puisque la question de l’entrée dans l’UE avait été l’un des points de fixation de la diplomatie russe au cours des années 2010. Les États-Unis n’ayant aucun souhait que l’Ukraine intègre l’OTAN, il reviendra aux Européens à gérer le dossier de Kiev. Une entrée qui devrait prendre beaucoup de temps si les exigences économiques et juridiques sont respectées. Si l’Ukraine bénéficie de passe-droits, cela provoquera l’ire de nombreux pays, notamment dans les Balkans, qui attendent depuis de longues années leur adhésion.
Balancement de la puissance
Les États-Unis ont repris aux Anglais la notion d’équilibre de la puissance. Cette pratique diplomatique a été mise en œuvre par Londres tout au long du XIXe siècle, de la période napoléonienne jusqu’à la Première Guerre mondiale.
Cet équilibre consiste à maintenir sa croissance pour rester numéro 1 tout en s’alliant systématiquement avec le numéro 3 afin de contrebalancer la puissance du numéro 2. Et ainsi éviter qu’il ne prenne la première place. Quand, par ce jeu, le troisième devient deuxième, alors les alliances évoluent. Dans cette pratique, ce ne sont pas des pays qui sont soutenus, mais des positions. Le 1 s’allie avec le 3 contre le 2. Et peu importe qui est le 3 et le 2. Du temps de la puissance européenne, le 2 et le 3 ont alterné entre la France et l’empire allemand. Aujourd’hui, c’est la Chine et la Russie.
Du temps de l’URSS, Henry Kissinger avait ainsi convaincu Richard Nixon de se rapprocher de la Chine pour contrer l’hégémonie soviétique. Il fallait surtout éviter la formation d’un grand bloc d’alliance qui contrôle l’Eurasie. C’est la fameuse thèse d’Halford Mac Kinder : qui tient la Terre du Milieu tient le monde. Donc, il faut briser l’alliance des puissances continentales afin d’éviter qu’elles ne contrôlent cette terre centrale. L’idéologie ne joue qu’en second plan. Peu importe que la Chine soit maoïste, l’ennemi était alors l’URSS. Cette politique a permis d’isoler Moscou.
Au cours des années 1990, un nouvel adversaire se dresse : le Japon. Sa puissance industrielle, portuaire, technologique en fait un numéro 2 dangereux pour les États-Unis. Soutenir la Chine, notamment pour son entrée dans l’OMC, permet alors de contrer la puissance économique japonaise, tout en s’assurant d’une alliance avec « l’usine du monde ». Au même moment, les relations avec la Russie de Poutine sont au beau fixe, ce dernier autorisant même les troupes de l’OTAN à installer des bases provisoires en Asie centrale afin de mener les opérations militaires en Afghanistan.
Puis, quand la Russie redevient une puissance économique, fondée sur la rente des hydrocarbures, un nouveau danger peut se profiler. D’où l’attrait de certains démocrates pour l’Ukraine au cours des années 2000-2010.
Mais c’est ici surtout la faiblesse des Européens qui attisent le ventre mou ukrainien, plus qu’un plan géopolitique des Américains qui n’ont jamais été véritablement intéressés par l’Ukraine. Pour beaucoup d’analystes, dans le sillage de Samuel Huntington, le véritable danger réside dans le Mexique, et donc la frontière sud, car c’est par lui qu’arrivent les migrants et la drogue. Les États-Unis laissent alors les Européens gérer leur arrière-cour ukrainienne et s’occuper de la paix sur leur continent, ce qu’ils se sont avérés incapables de faire, comme ils avaient été incapables de gérer la crise yougoslave.
Aujourd’hui, si Donald Trump se rapproche de la Russie c’est parce qu’il voit en Moscou un numéro 3 à utiliser contre le numéro 2. La Russie sort de cette guerre plus vassalisée que jamais à la Chine. Son économie est dépendante de Pékin, notamment pour l’exportation des hydrocarbures. Dans les rues de Moscou circulent des voitures chinoises et les industriels chinois ont remplacé les Européens. Il y a donc risque d’une nouvelle alliance de la Terre du Milieu, avec une Russie qui serve de matières premières à la Chine. Donald Trump fait donc du Nixon renversé. Cette fois-ci, il se rapproche de Moscou pour couper la route avec Pékin. Et il le fait en Arabie saoudite, fidèle alliée de Washington, mais qui conserve des liens avec Moscou.
Par-dessus l’Europe
Le risque pour Zelensky est que le sort de son pays se négocie sans lui. Les Européens ont eu beau se retrouver à Paris, ils sont surtout démontrés qu’ils n’ont aucune prise sur les événements, qui leur seront dictés par les deux protagonistes. Quant au Royaume-Uni, opposant historique aux Russes et soutien sans faille de l’Ukraine, il est lui aussi absent. C’est qu’en Europe, il n’y a plus grand monde. Olaf Scholz devrait connaître une grande défaite à la fin de la semaine. Emmanuel Macron est hors-jeu, Keir Starmer est insignifiant. Il n’y a que Giorgia Meloni qui arrive à peser un peu sur la scène européenne, auréolée des bons résultats de l’Italie. Mais son pays est sur un alignement complet des États-Unis, ce qui limite les marges de manœuvre internationales. Le train de l’histoire avance et beaucoup le regardent passer.