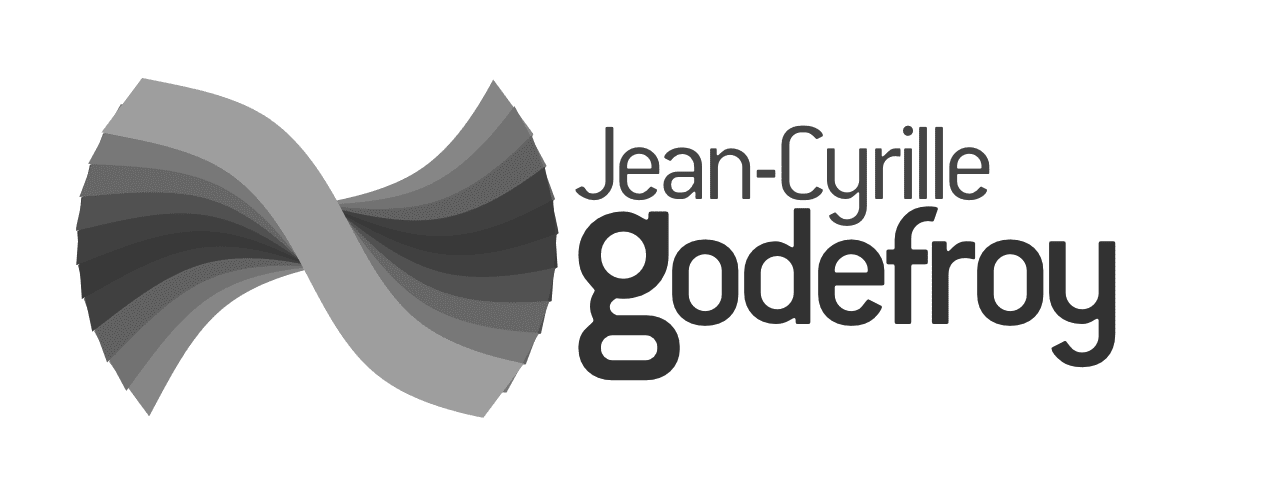Par Giuseppe Gagliano, Président du Centro Studi Strategici Carlo De Cristoforis (Côme, Italie)
À la lumière de la tragédie ukrainienne, le jugement historique sur la classe dirigeante de l’Union européenne mérite lui aussi une réévaluation profonde. Non pas tant pour ce qui s’est passé en 2022, mais pour ce qui aurait pu être évité au cours des trente années précédentes. Car si Washington a pris, depuis l’époque de George W. Bush, des décisions provocatrices et imprudentes vis-à-vis de la Russie, Bruxelles et les capitales européennes ont brillé par leur absence de retenue ou de clairvoyance. Pire encore, elles ont souvent applaudi.
Robert Gates, ancien secrétaire à la Défense, l’a écrit clairement dans ses mémoires : la longue liste des actions unilatérales américaines – depuis le retrait du traité ABM en 2002 jusqu’à l’expansion de l’OTAN vers l’Est, en passant par la reconnaissance du Kosovo et le soutien à l’indépendance de la Géorgie et de l’Ukraine – constituait une suite de provocations délibérées. Le Kremlin l’a noté, tandis que l’Occident rejetait tout signe d’inquiétude comme une nostalgie soviétique mal digérée. L’Union européenne, censée être la gardienne de la paix sur le continent, a suivi sans broncher.
En 2021, alors que Moscou renforçait ses capacités militaires et que l’Ukraine devenait un terrain d’exercices pour l’OTAN, les dirigeants européens décidèrent de participer à des manœuvres conjointes sur le sol ukrainien. Personne, ni à Berlin, ni à Rome, ni à Paris, ne s’est demandé si cela ne constituait pas l’ultime étincelle. L’Europe, au lieu de contenir la Maison Blanche, s’est laissée entraîner dans sa stratégie d’endiguement, sans jamais remettre en question l’équilibre géopolitique qui vacillait.
Ainsi, lorsque la Russie lança son offensive en février 2022, le monde fut pris de court — mais pas le Kremlin. L’Union européenne remit son destin entre les mains de Washington. Aucune initiative diplomatique autonome, aucune réflexion sur les erreurs passées. En Italie, Mario Draghi demanda immédiatement l’envoi d’armes « létales ». Les marges pour un cessez-le-feu, encore praticables dans les premiers jours du conflit, furent écartées au nom de la « victoire sur le terrain ».
Et pourtant, les archives parlent d’elles-mêmes. Les demandes russes lors des premiers pourparlers de mars 2022 — neutralité de l’Ukraine, respect de la langue russe dans le Donbass, expulsion des forces néonazies, reconnaissance de la Crimée — étaient modérées. Même la BBC l’a reconnu : « les demandes du président Poutine ne sont pas aussi dures que certains le craignaient ». Mais l’Europe, aveugle et sourde, s’est rangée à la ligne la plus dure de Biden, confondant illusion de puissance et réalité des rapports de force.
Aujourd’hui, en 2025, le bilan est sévère. L’Union européenne dispose d’une armée inadéquate, sans capacité défensive autonome. Les systèmes de défense aérienne sont insuffisants pour protéger ses villes, les blindés sont peu nombreux, certains ont même été donnés à Kiev. La présidente Ursula von der Leyen a annoncé un plan de réarmement de 800 milliards d’euros : un aveu implicite d’échec stratégique.
Mais les dégâts les plus graves ne sont pas militaires. Ils sont politiques. L’Europe a abandonné sa voix, sa diplomatie, sa capacité de médiation. Elle a préféré confier à Washington la gestion de la crise la plus dangereuse des soixante-dix dernières années, rejetant toute hypothèse de compromis ou de dialogue.
Et pendant que Trump, redevenu central dans le jeu international, implore la clémence pour les troupes ukrainiennes encerclées à Koursk, l’Europe reste silencieuse, sans outils ni direction. Elle n’a parlé qu’avec les armes, et maintenant que les armes manquent, elle n’a plus rien à dire. Elle a choisi la force sans en avoir les moyens, et elle a perdu la politique. Elle a refusé la reddition et récolté la débâcle.
En somme, la guerre en Ukraine a réfuté l’hypothèse occidentale selon laquelle la Russie serait un colosse aux pieds d’argile. Le contraire s’est produit : la Russie a résisté aux sanctions, réorganisé son industrie militaire et repris l’initiative stratégique. L’Union européenne, elle, a perdu son cap et sa souveraineté politique. Pour ne pas répéter ces erreurs, les slogans ne suffisent pas : il faut une autocritique lucide. Il faut une véritable réflexion historique et stratégique sur le rôle de l’Europe — non pas comme l’écho de la Maison Blanche, mais comme acteur autonome dans un monde multipolaire.