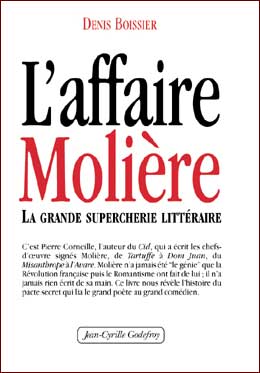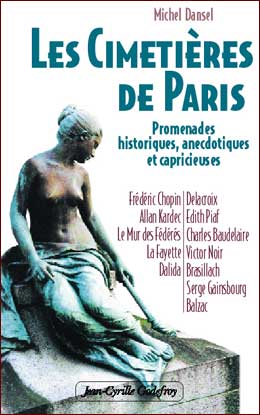Description
Les Européens sont victimes d’un déni de nation. Alors que le modèle de l’État-nation est dominant dans le monde, les peuples européens sont sommés d’y renoncer pour se dissoudre dans l’universel.
Chaque groupe humain a besoin d’un cadre correspondant à son identité, et dons la forme la plus adéquate est aujourd’hui l’État-nation.
Jugée normale pour les États-Unis, la Chine ou l’Inde, la fierté nationale est interdite à la France. Celle-ci, reniant son histoire et sa culture, devient un insipide Hexagoland à la dérive, noyé dans une calamiteuse Union européenne qui n’aime pas les Européens et ne veut pour identité collective qu’une ouverture inconditionnelle à l’autre.
L’exemple de petites nations fières de leur particularisme et résolues à le préserver, comme Israël ou la Suisse, montre que, pour un pays, mieux vaut être seul et déterminé plutôt que mêlé à un groupe confus et tyrannique qui le fait mourir à petit feu.
Le salut de l’Europe passe par la réintroduction d’un nécessaire et légitime particularisme national. Il faut faire revivre les peuples d’Europe, en recentrant l’État sur la nation.