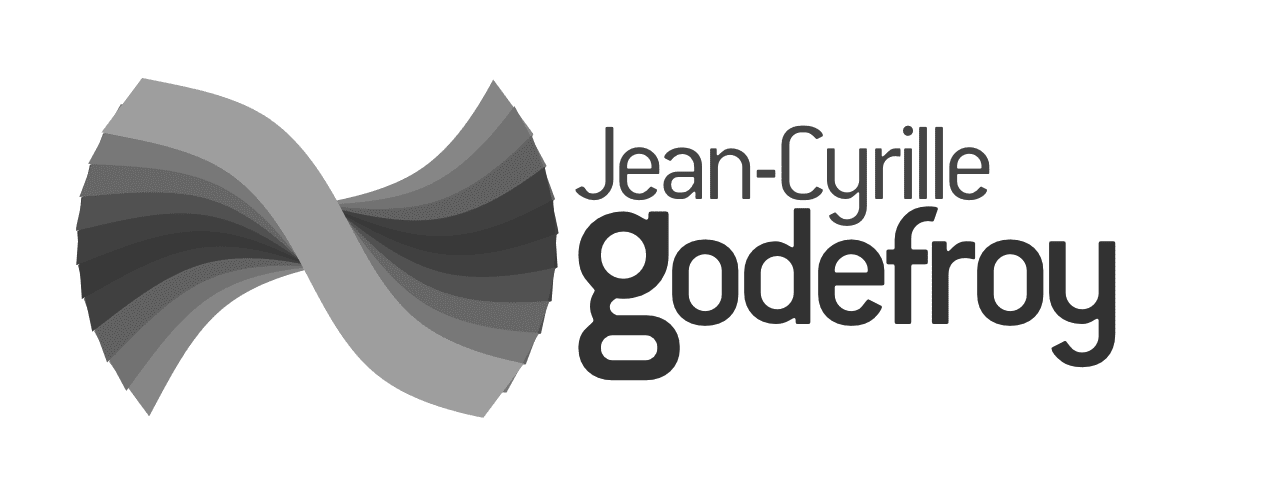Par Roland Lombardi / 6 avril 2025
Le Diplomate
Éric Denécé, est un ancien analyste du renseignement français, docteur en Science Politique, directeur du Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) et auteur de nombreux ouvrages sur les questions de sécurité, de renseignement et des affaires internationales. Dans cet entretien exclusif pour Le Diplomate, il évoque le troisième ouvrage collectif consacré à la guerre en Ukraine, publié et édité par le CF2R.
Propos recueillis par Roland Lombardi
Le Diplomate : Votre nouveau livre, Les conséquences géopolitiques de la guerre d’Ukraine, est votre troisième ouvrage sur ce conflit. Qu’est-ce qui vous a poussé à approfondir encore une fois ce sujet et quelles sont les principales nouveautés apportées par ce volet ?
Ce troisième ouvrage collectif du CF2R consacré à la guerre d’Ukraine examine les conséquences de ce conflit sur les équilibres géopolitiques et les nouveaux rapports de force internationaux qui en résulteront. Il analyse les raisons de la poursuite d’un affrontement dont l’issue apparait clairement défavorable à Kiev et de l’obstination des Européens. Il cherche à comprendre si une solution négociée est véritablement souhaitée et pour quelles raisons certains acteurs, qui profitent de cette guerre, ont intérêt à la voir durer.
L’ouvrage décrit également la manière dont ce conflit a accéléré l’émergence d’un ordre mondial multipolaire, dans lequel la remise en cause de l’Occident par le reste du monde apparait irrémédiable. Enfin, il s’attache à discerner ce que sera la nouvelle configuration de l’ordre international lorsque les armes se tairont, et quelles leçons doivent en tirer l’Europe et la France pour leur politique et leur avenir.
Cependant, comme il a été publié avant l’entrée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les récentes évolutions n’y sont pas abordées ?
LD : Dans vos analyses, vous insistez sur la nécessité d’adopter une approche « réaliste » de la politique internationale. Pourriez-vous expliquer comment la perspective de la Realpolitik vous a guidé dans votre lecture de la guerre en Ukraine ?
La Realpolitik, est la prise en compte réaliste des rapports de force. Cette approche des relations internationales est en vigueur tant à Moscou, Pékin qu’à Washington. Que l’on aime ou pas, c’est une réalité. Les Américains l’ont compris. La stratégie des Démocrates a échoué, Washington ne peut faire face simultanément à deux adversaires majeurs (Russie et Chine). Les Républicains ont compris qu’il leur fallait faire un choix, car ils savent qu’il leur fond reconstruire un appareil de défense qui n’est pas dimensionné pour ce type de situation. Ils donc décidé de s’adapter.
Les Européens s’insurgent d’une telle évolution, à tort. Rappelons que des États qui ont confié depuis 1945 (Europe) leur sécurité à un protecteur (USA) ne peuvent s’en affranchir et n’ont guère droit à la parole. Ce déni de réalisme se paie un jour. Et nous en sommes à ce stade : mise à l’écart des négociations sur la sortie de crise, et qualification justifiée de « profiteurs », par la nouvelle administration américaine.
LD : Vous soulignez l’impact mondial de cette guerre, tant sur les équilibres stratégiques que sur la sécurité alimentaire et énergétique. Quels sont, selon vous, les principaux bouleversements géopolitiques qui en découlent ?
LA grande question est de savoir si nous allons vers une situation mondiale multipolaire, donc plus équilibrée, dans laquelle les négociations entre États permettront de résoudre l’essentiel des différends, ou si nous allons assister à une tentative des Etats-Unis de maintenir, voire de renforcer leur hégémonie sur le monde. C’est sans doute ce qu’espèrent les Américains. Mais Trump est réaliste, il a compris qu’il devait d’abord réindustrialiser son pays, lui redonner de l’élan, accaparer de nouvelles ressources, (Groenland, Panama, Canada) pour jouer ce rôle. Ce n’est absolument pas gagné. Je pense plutôt que nous allons assister dans les années à venir à un sursaut américain, mais qui ne fait qu’annoncer le déclin progressif de ce pays – et de l’Occident – dans le monde après plus de trois siècles de domination.
LD : Le conflit en Ukraine a mis en évidence des tensions accrues entre l’Europe et la Russie, et plus largement entre les États-Unis et la Chine. Comment analysez-vous justement la recomposition des alliances internationales, notamment avec le changement de la politique américaine vis-à-vis de ce conflit avec le retour de Trump aux affaires et les initiatives actuelles de négociations et de paix en cours entre Washington et Moscou ?
C’est la question à laquelle il est le plus difficile de répondre, notamment tant que les négociations russo-américaines n’ont pas abouti… ou échoué !
Si les deux pays parviennent à s’entendre – ce qui me parait aujourd’hui le plus probable –, la paix reviendra en Europe et les Américains pourront se consacrer à la « Menace chinoise ». Il ne s’agit pas d’une menace contre la sécurité des USA, mais contre leur hégémonie, ce qu’ils ne supportent pas. Dès lors, assisterons-nous à une confrontation « pacifique », c’est-à-dire essentiellement économique, ou à une nouvelle guerre froide ? Difficile à prévoir.
Si aucun accord n’est signé entre Moscou et Washington, que la guerre se poursuit et que les Américains reprennent leur assistance à Kiev, le conflit pourrait bien durer encore 12 à 18 mois. Mais l’issue en est déjà scellée. L’Ukraine, même soutenue par l’Occident, ne peut pas gagner, et la Russie ne peut perdre. Évidemment, demeure le risque d’une escalade nucléaire incontrôlée qui pourrait en découler.
À lire aussi : Prévisions, réalités et perspectives du conflit russo-ukrainien
LD : Au niveau européen, le changement de paradigme américain, la guerre a ravivé des débats sur la défense commune et l’autonomie stratégique. Quels enseignements tirez-vous de la réaction quasi hystérique des pays européens face à ce conflit et quels défis restent à relever pour l’Europe ?
Cette réaction se fonde sur plusieurs éléments. D’abord, les Européens poursuivent la politique des néoconservateurs de l’équipe Biden derrière laquelle ils se sont rangés depuis quatre ans. Ne doutons pas un instant qu’ils soient encouragés par les Démocrates américains qui, depuis leur défaite électorale, tentent de saboter la politique étrangère de Trump.
Ensuite, les Européens ont le sentiment, certes pas infondé, d’être lâchés, trahis par les Américains. Ils oublient un peu vite que la majorité d’entre eux ont pris fait et cause pour les Démocrates, contre Trump, depuis plus de quatre. La nouvelle administration américaine s’en souvient et règle ses comptes en montrant aux Européens, qui n’assurent même pas leur propre défense, qu’ils sont quantité négligeable.
La tentative de construire, en réaction, une Europe de la Défense me semble être une illusion dont nous verrons rapidement les limites, soit parce que les Américains continueront d’imposer leurs armements à la majorité des États du Vieux continent ; soit que les Européens développeront entre leurs industries une nouvelle concurrence qui générera de fortes rivalités…
LD : En tant que directeur du CF2R, vous accordez une attention particulière aux enjeux de renseignement et de sécurité. Comment ce conflit rebat-il les cartes du renseignement militaire et civil, tant pour les grandes puissances que pour les acteurs non étatiques ?
En matière de renseignement, il convient de différencier deux domaines : le renseignement militaire d’une part, l’espionnage et le contre-espionnage d’autre part.
En matière de renseignement militaire, ce conflit a mis en lumière une nouveauté fondamentale qui a eu un impact majeur sur la conduite du conflit : celle de la transparence du champ de bataille en raison de la multiplication des capteurs techniques de toute nature : satellites, aéronefs, drones, radars, système de guerre électronique, exploitation des sources ouvertes, etc. Cela signifie que la concentration des forces devient impossible dans risque et que la surprise tactique devient impossible. ON relève ainsi que pour échapper à la surveillance de l’ennemi et le surprendre la seule solution qui demeure est de creuser, de s’enterrer (cf. Ukraine et Gaza)
Nous avons également observé que le renseignement militaire humain (reconnaissance, pénétration dans le dispositif adverse, guidage des feux, contrôle aérien avancé) se trouvait réduit en fonction des lignes de front fortifiées et remplacé progressivement notamment par les drones. Cela ne veut pas dire que les unités spécialisées vont disparaitre, car les conditions de ce conflit ne seront pas nécessairement celles du suivant… mais cela va veut dire que leur rôle va évoluer.
En matière de renseignement et de contre-espionnage, il est pour le moment plus difficile de tirer des enseignements. Les deux camps ont bien sûr accru leurs opérations de pénétration et de recrutement au sein des centres de décisions politiques et militaires adverses et ont parallèlement renforcé leur dispositif de contre-espionnage ; mais nous ne disposons pas encore d’assez d’information pour en dresser le bilan. En revanche, les actions de renseignement opérationnel clandestines, et surtout les opérations de sabotage et d’assassinats, se sont multipliées des deux côtés.
LD : L’opinion publique joue un rôle grandissant dans la conduite des guerres modernes. Dans quelle mesure, à votre avis, l’information (voire la désinformation) et la guerre psychologique ont-elles influencé le cours du conflit et la perception internationale de celui-ci ?
En réalité, ce ne sont pas les opinions qui jouent un grand rôle, car ils sont généralement manipulés. Ce qui compte, c’est la manière dont les différents acteurs les orientent afin de construire le soutien dont ils ont besoin, tant pour justifier leur action que pour bénéficier d’un soutien populaire. Les chefs d’orchestre des deux camps sont les Spin Doctors, et leurs orchestres symphoniques sont les médias (classiques ou sociaux) sous leur contrôle. L’opinion n’est que la cible de leurs opérations.
La guerre psychologique (ou cognitive pour employer un mot à la mode) a joué et continue de jouer dans ce conflit un rôle primordial, atteignant une dimension qu’elle n’avait jamais atteint auparavant. Nous sommes en effet dans une guerre des représentations, fondée sur une utilisation massive des moyens modernes de production et de diffusion. Ce qui compte, ce n’est pas la vérité, mais la représentation que chaque belligérants en donne et auquel son public cible va adhérer sous l’effet du matraquage médiatique… et de la censure des informations adverses ou d’analyses indépendantes. Cela a aussi été rendu possible par le régression éducative et intellectuelle qui caractérise nos sociétés post-industrielles, dans lesquels les populations lisent de moins en moins, sont rivées à leurs écrans, gobant généralement ce qu’on leur sert ; elles ne sont plus capables de remettre en perspective les informations dont elles sont abreuvées et réagissent émotionnellement et non rationnellement. Cette évolution, quoi que négative, est une aubaine pour les opérations de désinformation par saturation auxquelles nous assistons. Et en la matière, le camp occidental est à la fois plus avancé et plus partial que la Russie
LD : Comment envisagez-vous l’évolution de la situation à moyen et long terme ? Pensez-vous que ce conflit pourrait servir de « leçon » diplomatique pour prévenir de nouvelles tensions armées, ou au contraire cristalliser des rivalités encore plus profondes ?
Je n’en suis malheureusement pas très sûr, du moins pour nous, Européens.
Dans ce conflit, les Russes ont eu la confirmation de la duplicité de l’Occident, qu’il s’agisse des Américains (depuis 1991) ou des Européens (depuis 2014). Ils n’ont donc plus aucune confiance dans ces partenaires et les promesses qu’ils font ou les engagements qu’ils prennent. C’est pour cela qu’ils regardent avec prudence la nouvelle politique américaine conduite par Trump. Si, pour le moment, l’évolution leur est plutôt favorable, les Russes ont compris que Washington pouvait faire volte-face à n’importe quel moment, pas seulement à l’occasion d’élections.
Côté américain, il faut reconnaitre que la nouvelle administration accepte totalement la défaite de la stratégie de l’équipe précédente dont le but était de mettre la Russie à genoux. Trump et ses conseillers assument cette situation et veulent y mettre un terme rapidement, pour passer à autre chose, notamment afin de préparer une éventuelle confrontation avec la Chine.
Pour ce qui est des Européens, le pathétique le dispute au risible. Après avoir soutenu la politique américaine contre Moscou depuis 2014 (Maidan) et s’être laissé entrainer dans ce conflit dont ils ont payé le prix fort (énergie, inflation, dépendance des USA, etc.), ils semblent déterminés à le poursuivre alors que les deux principaux belligérants négocient la paix. Or, ils n’en ont pas les moyens, ni politiques, ni financiers, ni militaires. Ce sont des grenouilles qui essaient de se faire aussi grosses que les bœufs… et qui vont exploser, gonflées de leur suffisances… et de leurs insuffisances.
Il y a certes des raisons qui justifient cet acharnement et cette attitude insensée, notamment la volonté de profiter de cette crise pour avancer à marche forcée vers une intégration européenne que les peuples ne souhaitent pas mais que les élites politiques et technocratiques veulent leur imposer.
LD : Enfin, faisons un focus particulier sur la position de la France aujourd’hui et qui semble la plus belliqueuse notamment par la voix de son président Emmanuel Macron. Comment l’expliquez-vous ?
En effet, c’est Emmanuel Macron qui est aujourd’hui le plus excessif dans cette logique. Se politique est littéralement suicidaire pour notre pays. Après s’être durablement brouillé avec Poutine, il prend aujourd’hui la tête d’une « fronde » européenne contre Donald Trump. Il a perdu tout crédit, toute respectabilité, et va se mettre les plus grands dirigeants de la planète à dos, ce qui sera particulièrement dommageable pour la France.
On est en droit de se demander ce qu’il veut, comment il raisonne… Pourquoi est-il incapable d’appréhender la réalité qui prend forme ? Sans doute le rêve d’une Europe intégrée dont il pourrait être le leader après deux mandats à l’Élysée le hante-t-il ? Sans doute sa volonté d’exister, en France, dans un contexte de défiance à son égard le pousse-t-il à vouloir faire diversion. Toujours est-il que, chaque fois qu’il lance une nouvelle idée pour aider l’Ukraine, il est rapidement contredit voire lâché par ses partenaires européens qui le trouvent excessif et mesurent les risques qu’il y a à la suivre. Tous reviendront – malheureusement – , plus vite que nous ne le pensons, dans le giron américain. Et nous, Français, paieront le prix de l’intransigeance stupide de Macron.