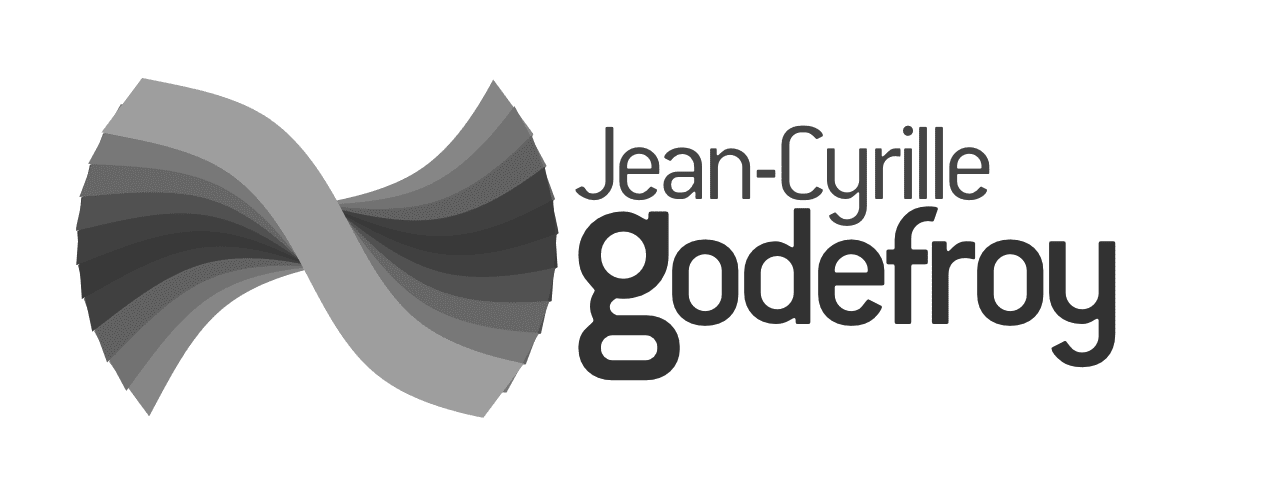Par Giuseppe Gagliano, Président du Centro Studi Strategici Carlo De Cristoforis (Côme, Italie)
Croire que la guerre est une anomalie relève de la propagande. Pour les réalistes, elle est la norme. À une époque comme la nôtre, où chaque conflit est habillé des oripeaux moraux de la condamnation ou de la rédemption, parler de réalisme offensif semble presque blasphématoire. Et pourtant, si l’on a le courage de mettre de côté l’émotion et d’observer les conflits à travers le prisme de la théorie, on s’aperçoit rapidement que l’utopie de la paix perpétuelle n’est justement qu’une utopie.
Le réalisme offensif, dans toute sa rudesse, affirme une vérité aussi dérangeante qu’incontournable : les États ne recherchent pas la paix, mais la sécurité par la domination. Et dans l’anarchie du système international, où aucune autorité supérieure ne peut garantir la protection, chaque grande puissance est contrainte de penser et d’agir en termes de force. L’hégémonie régionale devient alors le but suprême.
John Mearsheimer, l’un des théoriciens les plus pénétrants du réalisme structurel, le répète depuis longtemps : l’erreur fondamentale de l’Occident a été d’ignorer la perception stratégique de la Russie. Pousser l’OTAN aux frontières russes, inclure Kiev dans l’orbite euro-atlantique, signifiait franchir une ligne rouge que Moscou considère, depuis toujours, comme intangible. La réaction, selon la logique réaliste, ne pouvait être qu’inévitable.
À lire aussi : Le wokisme fait le jeu d’un projet politique qui le dépasse
Ce n’est pas Poutine qui explique la guerre, mais la continuité historique de la puissance russe
Pour qui observe les relations internationales avec les outils de la géopolitique et de l’histoire, la guerre du 24 février 2022 n’est pas un éclair dans un ciel serein, mais le dernier chapitre d’une longue tradition. Depuis la Sainte-Alliance jusqu’au Pacte de Varsovie, de la doctrine Brejnev aux guerres de Tchétchénie et de Géorgie, la Russie a toujours réagi par la force à toute menace perçue contre sa zone d’influence. Il ne s’agit donc pas d’une question morale, mais d’une dynamique stratégique profondément enracinée dans son identité impériale.
Mearsheimer, dans un discours prononcé à l’Institut Universitaire Européen de Florence en juin 2022, l’a dit sans ambiguïté : l’objectif de la Russie n’est pas de détruire l’Ukraine par cruauté, mais d’empêcher sa sortie définitive de la sphère d’influence russe. Une « question existentielle », comme il l’appelle, qui entre pleinement dans les paramètres de ce que les réalistes appellent la « politique de puissance ».
L’accusation de “pro-poutinisme” révèle l’incapacité à distinguer l’analyse de la justification
De nombreux commentateurs libéraux accusent les réalistes offensifs de faire preuve d’indulgence envers Moscou, parce qu’ils refusent de condamner clairement l’invasion. Mais c’est là une erreur fondamentale : le réalisme ne s’occupe pas de juger, mais d’expliquer. Contrairement au libéralisme ou au marxisme, qui injectent de l’idéologie dans l’analyse, le réalisme s’appuie sur l’observation empirique et sur l’historicité des comportements étatiques.
Cela ne signifie pas approuver la guerre, mais refuser de la réduire à une opposition morale entre le Bien et le Mal. C’est la différence entre l’analyste et le moraliste. Les réalistes ne défendent pas la Russie, mais affirment que tout État, y compris la Russie, agit selon une logique de survie et d’influence. Ignorer cette logique, c’est précisément ce qui a aveuglé les politiques occidentales de ces trente dernières années.
Le néoréalisme et l’avertissement ignoré de 2001 : ne jamais perdre de vue l’intérêt national
Dès l’après-11 septembre, les penseurs néoréalistes avaient tiré la sonnette d’alarme contre l’unilatéralisme de l’administration Bush. Dans un article devenu célèbre, publié en mars 2001 dans International Security, Stephen Walt plaidait pour une stratégie d’ offshore balancing, selon laquelle les États-Unis devraient limiter leur présence militaire directe en confiant la sécurité régionale à des alliés locaux.
Mearsheimer, cette même année, écrivait dans The National Interest que l’obsession de la guerre globale contre le terrorisme disperserait inutilement les ressources américaines. C’était un avertissement lucide et rationnel : éviter que l’empire américain ne se dilue dans des missions dépourvues d’un intérêt national clair. Et lorsqu’en septembre 2002, trente-trois universitaires signèrent dans le New York Times un appel contre la guerre en Irak, ils le firent au nom du réalisme, non du pacifisme.
L’Ukraine comme révélateur de l’ordre mondial post-bipolaire
La guerre en Ukraine, dans l’analyse néoréaliste, n’est pas seulement un affrontement entre deux États, mais le symptôme d’un ordre international en crise. Un ordre fondé sur l’expansion de l’OTAN et sur l’universalisme libéral, désormais à bout de souffle. Pour la Russie, l’Ukraine n’est pas un simple enjeu périphérique mais un pivot stratégique, symbole d’une influence perdue. Et l’erreur de l’Occident fut de traiter cet espace comme s’il était neutre, sans prendre en compte les perceptions russes.
Le risque, comme le soulignent encore les réalistes, est que l’Occident tombe dans le piège de l’idéologie, interprétant chaque mouvement russe comme une menace existentielle, et négligeant les fractures internes : entre l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest, entre la prudence allemande et l’intransigeance polonaise, entre le réalisme français et le moralisme britannique. Le surmenage stratégique n’est plus seulement américain : il est désormais aussi européen.
L’histoire comme antidote à la propagande
Au final, la leçon du réalisme offensif, aussi difficile soit-elle à avaler, est simple : les relations internationales ne se font pas avec des bons sentiments. Les jugements moraux peuvent rassurer, mais ils n’expliquent rien. Et si l’on veut vraiment comprendre pourquoi les guerres éclatent, il faut revenir à l’histoire, à l’intérêt national, à la logique des puissances. Non pour justifier l’agresseur, mais pour éviter de reproduire les erreurs du passé.
Car si l’on réduit la guerre à un affrontement entre supporters, et si l’analyse devient propagande, il ne reste que le bruit des armes. Et dans ce vacarme, la vérité s’efface.